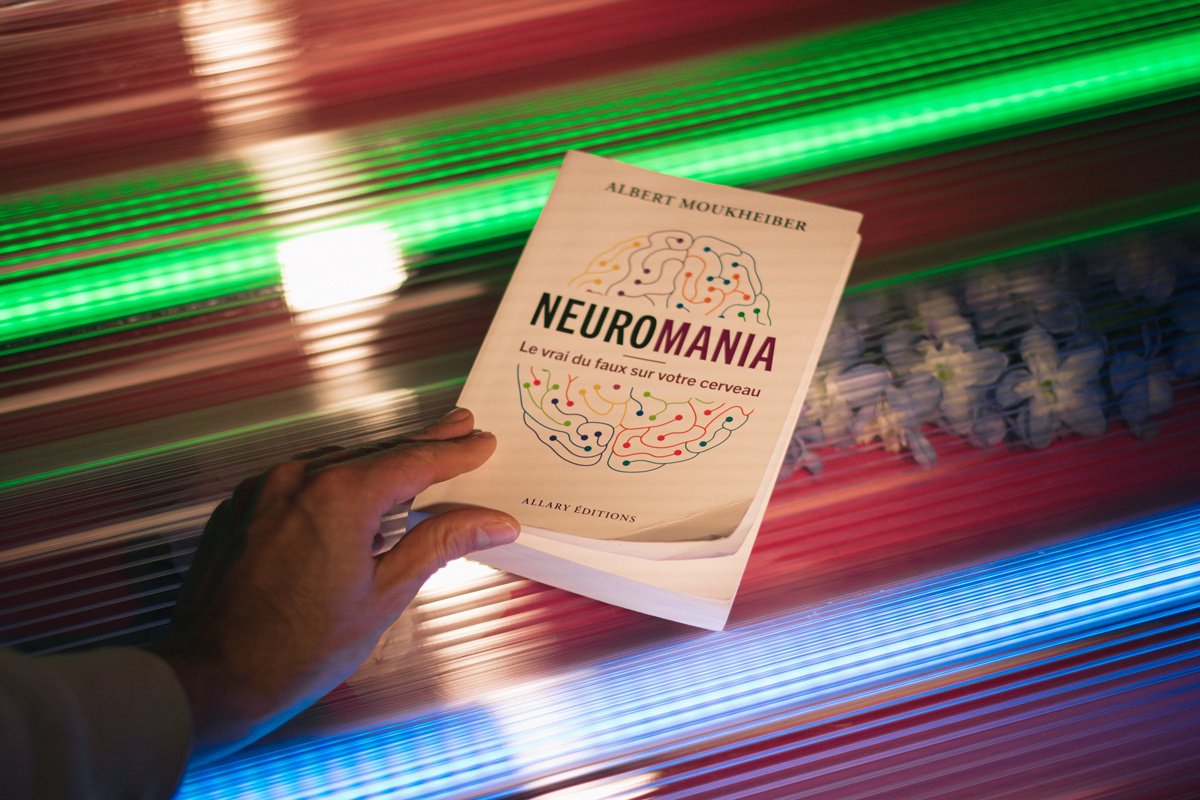« Le neuromanagement simplifie à outrance les vrais enjeux organisationnels »
Dec 11, 2024
4 mins

Les neurosciences fascinent le monde du travail, promettant (enfin) des réponses pour décrypter les comportements humains. Appliquées au management, elles suscitent néanmoins quelques réserves, entre apports éclairants et réductionnisme. Une mise à jour entreprise par le docteur en neurosciences Albert Moukheiber, dans son dernier ouvrage Neuromania (Allary, 2024).
Explorant le fonctionnement du cerveau et ses interactions avec le comportement humain, les neurosciences s’exportent aujourd’hui bien au-delà des laboratoires. En entreprise, elles s’appliquent à interpréter les leviers de la créativité, la résilience ou encore l’adaptabilité. Mais si l’univers du « neuromanagement » -ce courant qui utilise des concepts neuroscientifiques pour optimiser les pratiques managériales- est séduisant à plusieurs égards, est-il aussi fiable qu’on pourrait le croire ?
Pour Albert Moukheiber, si certaines idées sont fondées, beaucoup reposent, en revanche, sur des simplifications ou des interprétations abusives. Mais quels sont ces neuromythes prisés par les managers ? Et pourquoi faut-il s’en méfier ? Ou, à l’inverse, dans quelles circonstances est-il pertinent de s’y référer ? Entretien.
Dans Neuromania, vous mentionnez certaines croyances persistantes, comme celle du cerveau gauche et du cerveau droit. Quels sont les neuromythes les plus exploités en management ?
Albert Moukheiber : parmi les mythes les plus persistants, on trouve l’idée que certaines personnes seraient « plus analytiques » ou « plus créatives », selon qu’elles utilisent davantage leur cerveau droit ou gauche. Cette fausse croyance, bien qu’invalidée scientifiquement, reste omniprésente dans les discours en entreprise !
Un autre exemple fréquent est celui du cerveau triunique, souvent cité pour expliquer nos instincts primitifs. Selon cette théorie, notre cerveau serait constitué de trois parties issues de l’évolution : le cerveau reptilien, qui gère les instincts de survie comme fuir ou combattre ; le cerveau limbique, responsable des émotions de base et des comportements parentaux ; et le néocortex, qui permet le raisonnement et la prise de décision. Si cette idée repose sur des bases historiques, son application managériale simplifie excessivement la complexité de nos comportements.
Enfin, la notion de neuroplasticité, bien que scientifiquement validée, est souvent surexploitée : elle est érigée comme une solution magique pour surmonter toutes sortes de défis professionnels. Dans la même veine, les tests de personnalité – davantage une « psychomania » – envahissent le monde professionnel, promettant à tort d’améliorer la collaboration et le recrutement.
Un lien est souvent établi entre neurosciences et résistance au changement. Que pensez-vous de cette croyance, notamment dans le cadre des programmes de change management ?
A. M. : l’idée que le cerveau serait intrinsèquement programmé pour résister au changement est un raccourci simpliste. Les personnes ne sont pas naturellement réfractaires à la nouveauté. Tout dépend du type de changement. Si vous annoncez une augmentation de 10 % pour tout le monde, je doute qu’il y ait une quelconque résistance. En réalité, ce qu’on appelle « résistance » survient souvent lorsque les changements sont mal conçus, inutiles ou imposés sans concertation.
Il faut également prendre en compte le fait que l’adaptation demande du temps. Par exemple, un déménagement de bureaux ne génère pas une résistance en soi, mais nécessite une période d’ajustement. Plutôt que d’invoquer une résistance universelle liée au cerveau, il faut reconnaître que le changement est un processus temporel et contextuel. Enfin, ce discours sur la « résistance » s’accompagne souvent d’une forme d’infantilisation des salariés, avec des formations pour les « préparer » au changement… mais très peu pour les dirigeants. Si résistance il y a, elle devrait concerner toute l’organisation, non ?
+30 nuances d’IA : révolutionnez la fonction RH
Marque employeur, recrutement, expérience candidat et collaborateur, organisation RH, EVP… Plus de 30 idées pour utiliser l’IA dans votre quotidien.
Pourquoi le « neuromanagement » est-il si séduisant selon vous ? En quoi son usage peut-il se révéler problématique ?
A. M. : le « neuromanagement » séduit en proposant des solutions simples, arborées d’un vernis scientifique, à des problématiques complexes. Ajouter le mot « neuro » à tout propos confère instantanément une impression de crédibilité ! Des termes neuroscientifiques sont ainsi souvent employés pour légitimer des pratiques ou des outils qui relèvent, en réalité, d’autres disciplines, comme la psychologie. Prenons l’exemple de la PNL (Programmation Neuro-Linguistique), fréquemment présentée comme une méthode issue des neurosciences alors qu’elle repose sur des concepts de psychologie cognitive des années 1970. Ce glissement sémantique simplifie les enjeux, en les ramenant à des phénomènes liés au cerveau et donc à l’individu.
C’est là l’un des principaux dangers du neuromanagement : cette « inversion de responsabilité », où les neurosciences sont utilisées pour justifier des comportements ou des performances. Or, cette mécanique simplifie les défis organisationnels en les réduisant à des questions individuelles, tout en écartant des discussions cruciales sur la qualité de vie au travail, les salaires ou encore la gestion de la charge de travail. Les entreprises, souvent peu enclines à remettre en question leurs modèles, trouvent dans ces approches une façon commode de contourner les véritables problèmes. Ainsi, au lieu de repenser des aspects fondamentaux tels que l’organisation du travail, il est plus facile de dire à un salarié qu’il doit « travailler sa résilience ».
Malgré tout, les neurosciences peuvent-elles contribuer positivement au management ?
A. M. : à ce jour, les découvertes neuroscientifiques directement applicables au management sont très limitées. La plupart des concepts mis en avant, comme la sûreté psychologique, l’écoute active ou l’empathie, relèvent essentiellement de la psychologie ou du développement personnel. Et dans ces cas de figure, les neurosciences se contentent de valider scientifiquement des pratiques que nous connaissons déjà.
Là où elles apportent une réelle valeur, c’est dans la déconstruction de croyances erronées sur le cerveau et les comportements humains. Par exemple, elles permettent de remettre en question des idées reçues qui influencent encore certaines approches managériales. Mais, la complexité du cerveau fait que très peu de ces connaissances peuvent être directement traduites en applications concrètes généralisables au monde du travail.
Vous défendez une approche interdisciplinaire pour comprendre les comportements humains. Comment cette perspective pourrait-elle enrichir le rôle des managers pour dépasser cette « neuromania » ?
A. M. : il est crucial de comprendre qu’un même phénomène, comme une émotion ou un comportement, peut – et doit – être étudié à plusieurs niveaux. Au niveau biologique, on peut analyser l’activité cérébrale et les neurones. Au niveau subjectif, il s’agit de l’expérience personnelle de l’individu. En élargissant encore la perspective, on peut inclure les influences sociales, culturelles et anthropologiques. Ces niveaux d’explication sont complémentaires, et pour saisir pleinement les modèles humains, il est indispensable de les relier entre eux.
Les neurosciences, la psychologie, la sociologie ou l’anthropologie offrent chacune des modèles théoriques parfois morcelés ou contradictoires. Or, une approche pluridisciplinaire permettrait de construire des théories plus solides et mieux adaptées à la complexité des comportements humains. Avec une grille de lecture globale, un responsable d’équipe peut mieux appréhender les interactions humaines et identifier les leviers pertinents pour gérer les enjeux de son équipe.
__
Article rédigé par Laure Girardot et édité par Mélissa Darré, photo par Thomas Decamps.

More inspiration: Managing teams

La « trumpisation » du monde de l’entreprise est-elle en marche ?
Pour Olivier Fournout, la trumpisation du monde révèle une culture de la performance, dont Trump est le symbole extrême plutôt qu'une anomalie.
Apr 01, 2025

Managers : 6 conseils pour restaurer la confiance de votre équipe
« La confiance se gagne en goutte et se perd en litre »
Mar 19, 2025

Managers : comment accompagner un collaborateur en sous-performance ?
Échec ou opportunité ? Gérez la sous-performance avec intelligence.
Feb 11, 2025

La méthode Delphi : l'arme secrète pour mettre d'accord vos experts
Comment transformer 20 avis divergents en une stratégie claire ? La réponse se cache dans une méthode vieille de 70 ans.
Jan 22, 2025

Fidéliser vos meilleurs éléments : les secrets de la matrice des 9 cases
9 cases, 1000 possibilités : révolutionnez vos RH avec la méthode « 9-box ».
Jan 16, 2025
Inside the jungle: The HR newsletter
Studies, events, expert analysis, and solutions—every two weeks in your inbox