Pourquoi la France est-elle championne du burn-out en Europe ?
04. 6. 2024
7 min.

Ami·e, collègue, connaissance… Qui ne connaît pas, aujourd’hui en France, quelqu’un qui a « fait un burn-out » ? Rien de très surprenant quand on sait que l’Hexagone afficherait désormais l’un des taux de burn-out les plus élevés d’Europe. Mais pourquoi diable petons-nous autant de câbles au travail ?
« Après trois ans de sprint continu, j’ai fini par craquer. Je me suis effondrée lors d’une visite chez mon généraliste. J’étais venue pour un rhume, il m’a arrêtée pour épuisement professionnel. » Lorsque Laure, 32 ans, se fait arrêter, elle est alors chargée de communication dans une grande entreprise du monde de la mode. Des récits comme celui-ci, Paul Clément, médecin spécialiste du burn-out, en entend chaque jour un peu plus. « J’ai vu très nettement la montée du nombre de cas de burn-outs au cours de ma carrière. Il y a 15 ans, ça n’existait pas, et ce n’est pas uniquement parce que c’était moins détecté, je suis absolument persuadé qu’il y en avait moins. » Des propos corroborés par la psychologue du travail Marie Pezé, fondatrice des premières consultations Souffrance et Travail : « Depuis mes premières consultations, en 1995, la situation ne fait que s’aggraver. Et ce qui est dramatique, c’est que le burn-out touche des gens de plus en plus jeunes. »
Si aujourd’hui le burn-out reste difficile à quantifier du fait qu’il n’est pas officiellement reconnu comme maladie professionnelle, les études s’accordent néanmoins toutes sur le fait qu’il touche une part de plus en plus élevée de travailleurs français. Selon l’Institut de veille sanitaire, 480 000 personnes en France seraient en détresse psychologique au travail, et le burn-out en concernerait 7%, soit 30 000 personnes. Le 12e baromètre du cabinet Empreinte Humaine réalisé par OpinionWay est plus pessimiste. Il estime que 2,5 millions de personnes présenteraient un risque de burn-out « sévère ». Enfin, le cabinet Technologia, va encore plus loin et porte à 3,2 millions le nombre d’employés présentant un « risque de burn-out », soit 12% de la population active.
En 2021, l’étude Eurofound, qui évalue et quantifie les conditions de travail des salariés en Europe sur une base harmonisée, classait même la France en queue de peloton parmi les trente-six pays étudiés, à égalité avec l’Albanie, tandis que selon une étude du consortium de chercheurs Forum of Future de 2023, la France afficherait l’un des taux de burn-out les plus élevés d’Europe, à égalité avec le Royaume-Uni. Des résultats corrélés aux observations du Centre d’études de l’emploi et du travail européen. À partir de données recueillies entre 1995 et 2015, ce dernier démontrait que la France se distinguait de ses voisins européens par une dégradation lente mais persistante des conditions de travail, engendrant une plus grande vulnérabilité des travailleurs français à celles-ci.
La tyrannie des “objectifs chiffrés”
Les causes de cette dégradation sont multiples : concurrence internationale accrue, avec une plus forte pression exercée sur les salariés, développement majeur des nouvelles technologies, qui ont orienté l’ensemble de la culture d’entreprise vers la productivité, mais aussi, plus récemment, conjoncture économique peu favorable, avec un taux de chômage élevé (7,5%) et des créations de postes en baisse (113 800 créations nettes d’emploi sur l’année contre 346 600 créations nettes en 2022). Résultat, en France, un salarié sur deux est en situation de « travail tendu », selon l’expression de l’économiste et expert en organisation du travail Jean-Claude Delgénès. « Être en travail tendu signifie que le salarié est dans l’urgence permanente, confronté à des moyens qui manquent, des compétences qui font défaut, et tenu par des délais couperets. Ce travail dans l’urgence, très prégnant en France, met les gens dans un stress chronique, évidemment très préjudiciable à la santé. »
Céline, 31 ans et déjà un burn-out au compteur, se souvient encore de la pression qui pesait sur ses épaules en tant que commerciale. « Je travaillais dans une start-up dans le domaine culturel. Quand je suis arrivée, nous avions des objectifs très élevés, avec une pression énorme, mais très peu de moyens pour y parvenir. Au fur et à mesure, j’ai commencé à avoir l’impression que je n’arriverais jamais à abattre ma charge de travail. Le pire, c‘est que si jamais par miracle je me rapprochais de l’objectif à atteindre, il était revu à la hausse ! ». Si cette « direction par objectifs » est particulièrement présente en France, c’est aussi parce qu’elle est le résultat d’un mode de management spécifique à l’Hexagone, extrêmement verticalisé.
Un management trop hiérarchisé
« Nous sommes dans un pays héritier des grandes gloires de Louis XIV et de la monarchie républicaine, où le pouvoir était très centralisé », explique Jean-Claude Delgénès, qui a également fondé le cabinet Technologia. « Encore aujourd’hui, nous perpétuons une culture des élites, où tout se passe à Paris, dans les grandes écoles. Résultat, nous avons des personnes qui intègrent le monde du travail directement au top management, et qui sont dans ce que j’appelle un « management plaidoyer. » C’est-à-dire des gens qui pensent avoir tout compris, et expliquent aux autres, qui exécutent. » Ce management « vertical », typiquement français, Laure l’a évidemment vécu dans son entreprise. « À un moment donné, j’aurais pu solliciter l’aide de ma manager, mais je ne l’ai pas fait, car elle n’était pas compétente dans mon domaine » argue la chargée de communication. « Elle ne connaissait rien aux outils que j’utilisais, elle se contentait juste de regarder si j’atteignais ou non mes objectifs. »
Parce que les ordres « viennent d’en haut », les salariés ne se sentent pas inclus dans les décisions de l’entreprise, y compris dans celles qui les concerne. « Cette logique très descendante ne favorise pas la concertation. En France, le changement est imposé, et non décidé collégialement », regrette Jean-Claude Delgénès. Dans l’étude Santé et Itinéraire Professionnel de 2007 mené par la DREES et la DARES, 42% des salariés interrogés affirmaient même devoir faire face à des ordres contradictoires. « Le fait de subir une décision, d’être simple exécutant, est très mal vécu chez les salariés. Cela génère une perte de légitimité et un sentiment d’injustice, très récurrent dans les schémas du burn-out », constate le Dr Paul Clément. À cette toute-puissance du management vient s’ajouter un fort déclin du collectif, et du contre-pouvoir autrefois exercé par les représentants du personnel - et ce d’autant plus depuis la suppression des CHSCT en 2017.
Le management vertical, cette autorité des « sachants » envers les « exécutants » a aussi pour effet de négliger la véritable quantité de travail nécessaire à l’accomplissement d’une tâche. Parce que les managers n’ont pas nécessairement acquis leur poste grâce à leur expérience, mais plutôt à leur parcours académique, ils n’ont parfois pas de vision du travail réel effectué par les salariés. « Cette culture de l’indifférence au travail réel est terrible, souligne la psychologue du travail Marie Pezé. C’est un impensé dans ce pays. On n’arrive pas à connaître ce qu’est le travail réel, c’est-à-dire ce que font vraiment les femmes et les hommes pour que l’entreprise tourne. » Car bien souvent, pour que tout roule, il ne suffit pas de suivre la procédure : les employés font plus que leurs fiches de postes, sans pour autant obtenir de reconnaissance derrière.
« En France, nous avons une reconnaissance de façade », affirme Jean-Claude Delgénès du cabinet Technologia. « Il ne s’agit pas d’une véritable reconnaissance du travail fourni, où on va demander au salarié d’expliquer aux autres comment il a fait, de partager son savoir. » Face à ce manque, certains salariés tombent alors dans le piège du surinvestissement, donnant toujours plus, pour obtenir des remerciements toujours plus rares. « C’est alors qu’ils sont souvent déjà épuisés sur le plan psychique, que les salariés vont tenter de redonner un dernier coup de collier pour pouvoir retrouver une reconnaissance qu’ils ont l’impression d’avoir perdue. Et c’est ce qui les fait basculer dans l’effondrement », analyse l’économiste.
Mais pourquoi une telle répugnance à reconnaître à sa juste valeur le travail fourni ? « Le vrai problème dans notre pays, c’est la relation à l’autre », martèle l’économiste. Face à des pays où le management est plutôt bienveillant et inclusif, en France le management passe encore souvent par une mécanique de soumission des salariés face aux managers. Pire encore, le Dr Paul Clément a pu observer que chez certains de ses patients, la reconnaissance passait par un accroissement de la charge de travail : « Il est fréquent de promouvoir les gens en augmentant leur charge de travail, sans forcément augmenter significativement leur salaire d’ailleurs, ni même reconnaître la faisabilité de ces nouvelles tâches ». Et cette mécanique est d’autant plus nocive que dans notre pays, les salariés accordent une place toute particulière à la valeur travail.
Je travaille donc je suis
« Nous avons la spécificité d’accorder au travail une centralité en termes de construction identitaire qui n’existe pas dans d’autres pays. Aux États-Unis, par exemple, vous avez un travail fonctionnel, rémunérateur, et à côté, vous pouvez accomplir ce que vous avez envie d’accomplir sur le plan identitaire au sein d’associations », éclaire Marie Pezé. En France, le travail définit encore largement qui l’on est. Peut-être aussi parce que, pendant longtemps, il a été un acquis fragile.
« Il ne faut pas oublier qu’en France, nous avons quarante ans de chômage de masse derrière nous », pointe du doigt Jean-Claude Delgénès. « Et Aujourd’hui encore, si vous perdez votre job, c’est extrêmement compliqué d’en retrouver un. Résultat, les Français sont parfois prêts à faire de gros sacrifices pour garder leur emploi. » Au risque de se surinvestir, comme l’a fait Laure. « J’avais besoin de montrer à tout prix que j’étais performante, car quand je suis arrivée sur le marché du travail en 2008, j’ai tellement entendu que l’on ne trouverait pas de boulot, que je tenais absolument à le garder. »
Parce que le travail est au cœur du statut social, les Français ont aussi intégré sans surprise la culture du présentéisme. Selon un sondage mené par OpinionWay en octobre 2023, 55 % des salariés interrogés pensaient que les heures supplémentaires sont une preuve d’investissement au travail, et 29 % déclaraient faire l’objet de remarques de la part de leurs collègues quand ils quittent le travail plus tôt ou « à l’heure ». « Je ne compte plus le nombre de fois où je suis restée pour faire bonne figure, alors que j’étais tellement épuisée que je ne travaillais plus depuis plusieurs heures… » soupire Laure. « Il faut impérativement s’attaquer à ce socle du présentéisme », s’insurge Marie Pezé. « Les journées de travail doivent être des journées physiologiquement vivables, quitte à supprimer des congés, mais à avoir des journées travaillées plus légères. »
Mais alors comment, si ce n’est éradiquer, au moins diminuer la proportion de burn-out en France ? En mettant en commun les bonnes pratiques de nos voisins européens en termes de prévention par exemple, suggère Dominique Lhuilier, professeure émérite en psychologie du travail au CNAM. « Il y a des pays bien plus avancés que nous en matière de prévention de la santé, d’amélioration des conditions de travail… Collecter l’information sur ce qui se fait ailleurs pourrait nous donner des enseignements précieux pour prévenir la survenue des burn-outs en France. » Une autre piste serait également d’enseigner la bienveillance aux futurs managers dès l’université : « Dans les écoles, on commence seulement à enseigner l’empathie, la bonté, la compassion… Mais il faut que cela se généralise », insiste Jean-Claude Delgénès. Enfin, pour le docteur Paul Clément, il faudrait également faire évoluer le suivi du burn-out, en évitant de tomber dans la “psychiatrisation” systématique : « Les gens en burn-out sont trop souvent orientés vers un psychiatre, ce qui induit l’idée que c’est eux le problème. Or c’est un problème professionnel, et non individuel. Il conviendrait donc plutôt de les orienter vers des médecins généralistes compréhensifs, susceptibles de les prendre en charge de façon empathique, sans passer automatiquement par la case anti-dépresseurs. »
Management vertical, absence d’instances collectives, manque de prévention, présentéisme… Les obstacles sont encore nombreux pour faire baisser significativement les chiffres du burn-out. Pourtant, ce dernier a des conséquences majeures, autant sur le plan physique et psychique des salariés, que sur l’économie des entreprises. « Un burn-out, c’est 18 mois d’arrêt maladie en moyenne, affirme Marie Pezé. C’est un gouffre pour la Sécurité sociale. Si on agissait au cœur, c’est-à-dire sur l’amélioration des conditions de travail, cela serait bien plus bénéfique, pour tout le monde ».
Article écrit par Coline de Silans et edité par Clémence Lesacq - Photo Thomas Decamps pour WTTJ

Viac inšpirácie: Mutations

« Qu'est-ce que tu veux de plus ?! » : infos et absurdités sur la parité
« Avant 2022, il y avait plus d’hommes prénommés « Thomas » que de femmes dans les conseils d'administrations des grandes entreprises allemandes ! »
16. 9. 2024

David Le Breton : « En entreprise, nous sommes dorénavant seuls, ensemble »
« Il n’y pas pas d’éthique sans visage. » David Le Breton livre ses inquiétudes sur la qualité de nos relations au travail à l'ère du numérique.
23. 7. 2024

Société du matching : pourquoi la vie pro ne doit pas ressembler à Tinder
Pour Philippe Steiner et Melchior Simioni, le matching moderne dans le monde du travail individualise et dissout les collectifs. Tribune.
04. 7. 2024

« La valeur travail, qui nous pousse à produire toujours plus, c’est une arnaque ! »
Lydie Salvayre critique la valeur travail et prône la paresse dans son nouveau livre, questionnant notre rapport au travail et au bonheur.
17. 6. 2024

« On sauve pas des vies » : 50 phrases pour remettre le travail à sa (juste) place
« Rome ne s’est pas faite en un jour »… Ça vous dit quelque chose ?
11. 6. 2024
Novinky, ktoré to vyriešia
Chcete držať krok s najnovšími článkami? Dvakrát týždenne môžete do svojej poštovej schránky dostávať zaujímavé príbehy, ponuky na práce a ďalšie tipy.
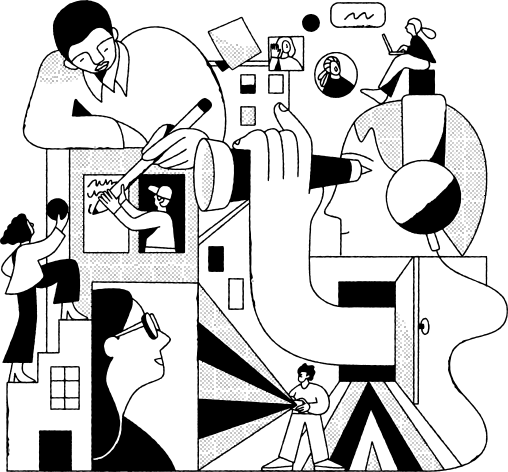
Hľadáte svoju ďalšiu pracovnú príležitosť?
Viac ako 200 000 kandidátov našlo prácu s Welcome to the Jungle
Preskúmať pracovné miesta

