Pauline Rochart : « Quitter la capitale, c’est troquer l’ambition pour l’ancrage »
20 févr. 2025
7min

Dans Ceux qui reviennent (Payot, 2025), Pauline Rochart explore le parcours de ceux qui, après des années passées dans les grandes métropoles, font le choix de revenir dans leur région d’origine. À travers de nombreux témoignages, elle décrypte ce retour souvent perçu comme un renoncement, un déclassement, mais qui, pour beaucoup, devient une quête d’ancrage et de sens, notamment dans leur rapport au travail. Entre quête de proximité, envie d’équilibre et nouvelles façons d’envisager sa carrière, son livre dresse le portrait sincère d’une génération qui réinvente la notion de réussite.
Après douze ans à Paris, où tu as travaillé et construit ta vie, tu as choisi de retourner dans ta région d’origine. Qu’est-ce qui a motivé cette décision ?
Avec du recul, je dirais que ce changement s’est imposé à moi. Pour beaucoup de provinciaux venus s’installer à Paris pour leurs études ou pour travailler, la trentaine marque un tournant. Tout semble en place professionnellement, mais c’est aussi l’âge où des événements viennent tout remettre en question : un enfant, une reconversion, une rencontre… ou des épreuves plus difficiles, comme un burn-out ou un licenciement. Dans mon livre, je cite l’essai Rupture(s) de Claire Marin, qui explore ces moments de bascule. En 2022, avec deux enfants, dont une petite d’un an, j’ai commencé à percevoir Paris autrement. Ce qui m’avait attirée au début – l’énergie, les opportunités – était devenu pesant. Le travail prenait toute la place, le rythme devenait étouffant, et je ne profitais plus vraiment de la ville. J’ai ressenti le besoin d’avoir plus d’espace et un quotidien plus apaisé.
Quitter Paris quand on a des enfants, c’est un choix courant. Mais pourquoi revenir dans le Nord, où les perspectives professionnelles peuvent paraître plus limitées ?
Je ne vais pas mentir, au début, on a d’abord pensé à Nantes ou Bordeaux, comme beaucoup de Parisiens qui ont du mal à envisager leurs vies en dehors des métropoles. Mais on a vite douté : est-ce qu’on n’allait pas juste reproduire notre vie parisienne ailleurs ? Même pression, loyers élevés… sans nos familles à proximité. Finalement, le Nord a été une évidence : on pouvait avoir plus d’espace et surtout on avait un soutien familial, indispensable quand on quitte Paris avec des enfants. Et au-delà de ces raisons pratiques, il y avait quelque chose de plus profond : l’ancrage. Si on n’a jamais idéalisé le coin où on a grandi, en revenant, tout a pris sens : les paysages, la lumière, les odeurs, les accents… Dans mon livre, je cite Nicolas Mathieu dans Leurs enfants après eux qui écrit cette phrase si juste : « L’effroyable douceur d’appartenir ». Ces quelques mots résument parfaitement ce paradoxe que l’on ressent quand on revient.
Et le travail dans tout ça ? Quitter Paris, c’est aussi s’éloigner d’un pôle où se concentrent les opportunités. Comment avez-vous abordé cette transition ?
C’est vrai que le travail, c’est une question centrale quand on quitte Paris. Est-ce qu’on va retrouver un emploi à la hauteur de nos compétences ? Est-ce qu’on ne risque pas de freiner sa carrière ? Franchement, dans notre cas, ça a été plus simple parce que mon compagnon, qui est dans la fonction publique, a trouvé un poste près de Dunkerque. Sans cette sécurité, on ne serait probablement pas revenus. De mon côté, je suis indépendante, donc je savais que je pouvais bosser de partout, même si ça impliquait de faire des allers-retours. Après, c’est vrai que dans un pays aussi centralisé que le nôtre, quitter Paris, c’est aussi s’éloigner d’un certain dynamisme professionnel, de ce pôle où se concentrent les pouvoirs : les grandes entreprises, les administrations, les institutions culturelles… Pour certains, c’est renoncer à une trajectoire ascendante, selon les critères classiques : un statut, un bon salaire, et des perspectives d’évolution.
Mais dans les témoignages que j’ai recueillis pour mon livre, beaucoup m’ont parlé de ce besoin de retrouver un travail plus concret. Mon compagnon, par exemple, est passé d’une grande administration à une petite collectivité de 4 000 habitants. Son métier n’a pas radicalement changé, mais son quotidien, si : il voit directement l’impact de ce qu’il fait, et franchement, c’est très valorisant. À Paris, on peut vite avoir le sentiment d’être déconnecté : des tâches parfois abstraites, des décisions prises de loin, un travail de plus en plus dématérialisé… En partant, en rejoignant de plus petites structures, on retrouve quelque chose de plus réel. Et oui, sur le papier, ça peut sembler être un pas en arrière, mais dans la réalité, beaucoup se sentent finalement plus épanouis.
Comment sont perçus ceux qui reviennent par ceux qui sont restés ?
Les personnes que j’ai interrogées pour mon livre sont généralement des enfants de la classe moyenne : filles et fils d’employés, d’agents de la fonction publique, d’enseignants, pas uniquement des transfuges de classe ou de grands bourgeois…. Et ce qui ressort de mon enquête, c’est que ceux qui reviennent reviennent plus « riches », en capitaux d’abord - les salaires en région parisienne sont plus élevés - mais aussi en expérience. En cela, ils disposent d’un véritable pouvoir social, une capacité à influencer leur environnement. Mais il faut être prudent, il ne s’agit pas de vouloir reconfigurer le territoire à son image. Pour se réintégrer, mieux vaut faire preuve de délicatesse, ne pas vouloir imposer ses modes de vie mais apprendre à écouter et à composer avec différents points de vue. Quitter Paris et sa « bulle de filtre » pour se réinstaller dans de petites villes, c’est aussi se relier à des gens qui ne pensent pas comme nous, ça invite à l’humilité.
Cela dit, l’étiquette de « Parisien » colle à la peau, surtout dans le milieu professionnel. Une expérience à Paris, c’est un peu comme une marque indélébile sur un CV. Même en étant originaire du coin, il faut parfois réaffirmer sa légitimité : rappeler qu’on a grandi dans tel village, qu’on a été au collège dans telle ville, qu’on connaît encore du monde. Sans ça, on reste « le Parisien », avec tout ce que ça véhicule de clichés – positifs ou négatifs. Du côté des employeurs, c’est plutôt bien vu. Ils valorisent souvent l’expérience parisienne, persuadés qu’elle apporte de nouvelles méthodes et une autre façon de travailler. Mais après plusieurs années à Paris, s’intégrer professionnellement en région, c’est aussi devoir reconstruire son réseau et s’adapter à de nouveaux repères.
Dans les témoignages que tu as recueillis, certains ont-ils vécu des désillusions, au point de vouloir repartir ?
Oui, c’est arrivé, mais il faut dire que ceux qui sont revenus n’avaient jamais vraiment coupé avec leur région d’origine. Du coup, il n’y avait pas cette idéalisation de la vie à la campagne. Moi, par exemple, quand j’étais à Paris, je revenais une fois par mois dans le Nord, donc ce n’était pas une redécouverte totale. Mais c’est vrai qu’il y a souvent un écart entre ce que j’ai appelé le retour projeté et le retour réel. Ce qu’on imagine en partant – l’accueil, les opportunités, la vie qu’on va se reconstruire – ne colle pas toujours avec la réalité. Et étrangement, les désillusions concernent souvent l’entourage familial.
Beaucoup reviennent en espérant un peu plus de soutien pour l’éducation de leurs enfants. Pourtant, une fois sur place, ils réalisent que les grands-parents ne sont pas toujours aussi disponibles qu’ils l’avaient imaginé. Ils sont contents de voir leurs enfants revenir, bien sûr, mais ça ne veut pas dire qu’ils vont être là tous les mercredis, ni qu’ils seront disponibles tous les samedis soirs. On imagine souvent que les grands-parents n’attendent qu’une chose : s’occuper de leurs petits-enfants. Dans les faits, surtout dans les milieux populaires où l’ascension sociale est souvent passée par le travail, beaucoup arrivent à la retraite avec l’envie de profiter enfin de leur temps libre.
Un témoignage m’a particulièrement marqué : un homme revenu au Mans pensait retrouver le modèle qu’il avait connu enfant, avec des grands-parents très présents. Mais ses parents, eux, passent leur temps en camping-car et, quand il leur demande de l’aide, la réponse est souvent : « Attends, il faut que je regarde mon agenda… »
Comment la famille perçoit-elle ce retour ? N’y voit-elle pas un retour en arrière, un déclassement ?
Forcément, ça interroge. Un enfant qui part à Paris pour réussir et qui revient quelques années plus tard, peut être perçu comme un échec. Pourquoi il ou elle revient ? Qu’est-ce qui n’a pas marché ? Pour les parents, surtout pour ceux de la génération des baby-boomers pour qui progresser dans la vie, c’était gravir les échelons, gagner plus d’argent, assurer sa stabilité. Quitter la capitale, c’est aller à contre-courant de cette vision. Alors que pour notre génération, la réussite se mesure différemment : moins en statut et en salaire, plus en qualité de vie.
Ce décalage peut être difficile à comprendre pour des parents qui ont tout misé sur le travail, à une époque où l’ascension sociale était encore possible. Aujourd’hui, on sait que le travail seul ne suffit plus à changer de catégorie sociale, que l’héritage pèse davantage. Mais comme eux continuent d’y croire, voir leurs enfants revenir dans une région moins dynamique les inquiète : ne prennent-ils pas un risque pour leur carrière ? Après, l’attachement familial compte aussi, et beaucoup se réjouissent du retour de leurs enfants. Les sentiments sont partagés : ils sont fiers de les voir réussir dans une grande ville, mais ils sont aussi soulagés de les savoir près d’eux.
Penses-tu que ce mouvement de retour vers des villes plus petites ou même la campagne va s’intensifier ? Pendant le Covid, on annonçait un exode urbain massif qui n’a pas vraiment eu lieu. Et plus récemment, avec les entreprises qui reviennent sur le télétravail, quitter les grandes agglomérations semble encore moins évident.
C’est vrai qu’on a beaucoup parlé d’exode urbain après le Covid, mais les études montrent bien que ce phénomène a été amplifié par les médias. Dans les faits, il n’y a pas eu de départ massif des villes : 80 % de la population française vit toujours en zone urbaine. Après, il y a bien un attrait pour les villes moyennes et certains territoires ruraux, mais il est très inégal. Des zones comme le littoral atlantique, le Sud-Ouest ou le pourtour méditerranéen attirent, alors que beaucoup d’autres régions et campagnes restent à l’écart de ce mouvement.
En revanche, ce que je remarque, c’est un vrai besoin d’ancrage chez notre génération. Et c’est souvent plus facile de trouver cet ancrage dans des villes moyennes, à taille humaine. Beaucoup des personnes que j’ai interrogées m’ont raconté qu’à Paris, elles se sentaient détachées et entretenaient un rapport presque « instrumental » à la ville : on y travaille, on consomme l’offre culturelle, les bars, mais on ne s’y sent pas forcément chez soi. Moi, par exemple, en douze ans à Paris, je n’ai jamais voté aux élections locales - je continuais à voter dans ma commune d’origine - parce que j’ai toujours eu le sentiment que Paris ne serait qu’un passage.
Il y a aussi, je crois, cette question essentielle de l’hospitalité : comment une ville accueille-t-elle ceux qui arrivent, mais aussi comment parvient-elle à offrir un avenir à ceux qui restent ? Donc non, il n’y a pas eu d’exode urbain au sens strict, même si Paris intra-muros perd effectivement des habitants. Mais on observe un mouvement vers des échelles de ville à taille humaine, où l’anonymat s’efface au profit de relations plus directes. Dans une petite ville, un village, on croise les mêmes visages au marché, à l’école, dans les cafés. Cette proximité nourrit un sentiment d’appartenance qu’on retrouve moins dans les grandes métropoles.
Article écrit par Romane Ganneval, édité par Aurélie Cerffond, photographie par Thomas Decamps

Inspirez-vous davantage sur : Mutations

« Qu'est-ce que tu veux de plus ?! » : infos et absurdités sur la parité
« Avant 2022, il y avait plus d’hommes prénommés « Thomas » que de femmes dans les conseils d'administrations des grandes entreprises allemandes ! »
16 sept. 2024

David Le Breton : « En entreprise, nous sommes dorénavant seuls, ensemble »
« Il n’y pas pas d’éthique sans visage. » David Le Breton livre ses inquiétudes sur la qualité de nos relations au travail à l'ère du numérique.
23 juil. 2024

Société du matching : pourquoi la vie pro ne doit pas ressembler à Tinder
Pour Philippe Steiner et Melchior Simioni, le matching moderne dans le monde du travail individualise et dissout les collectifs. Tribune.
04 juil. 2024

« La valeur travail, qui nous pousse à produire toujours plus, c’est une arnaque ! »
Lydie Salvayre critique la valeur travail et prône la paresse dans son nouveau livre, questionnant notre rapport au travail et au bonheur.
17 juin 2024
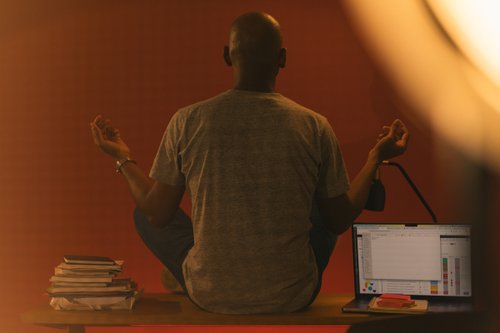
« On sauve pas des vies » : 50 phrases pour remettre le travail à sa (juste) place
« Rome ne s’est pas faite en un jour »… Ça vous dit quelque chose ?
11 juin 2024
La newsletter qui fait le taf
Envie de ne louper aucun de nos articles ? Une fois par semaine, des histoires, des jobs et des conseils dans votre boite mail.
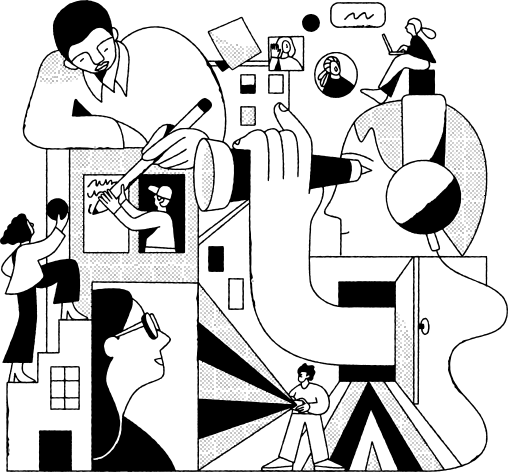
Vous êtes à la recherche d’une nouvelle opportunité ?
Plus de 200 000 candidats ont trouvé un emploi sur Welcome to the Jungle.
Explorer les jobs


