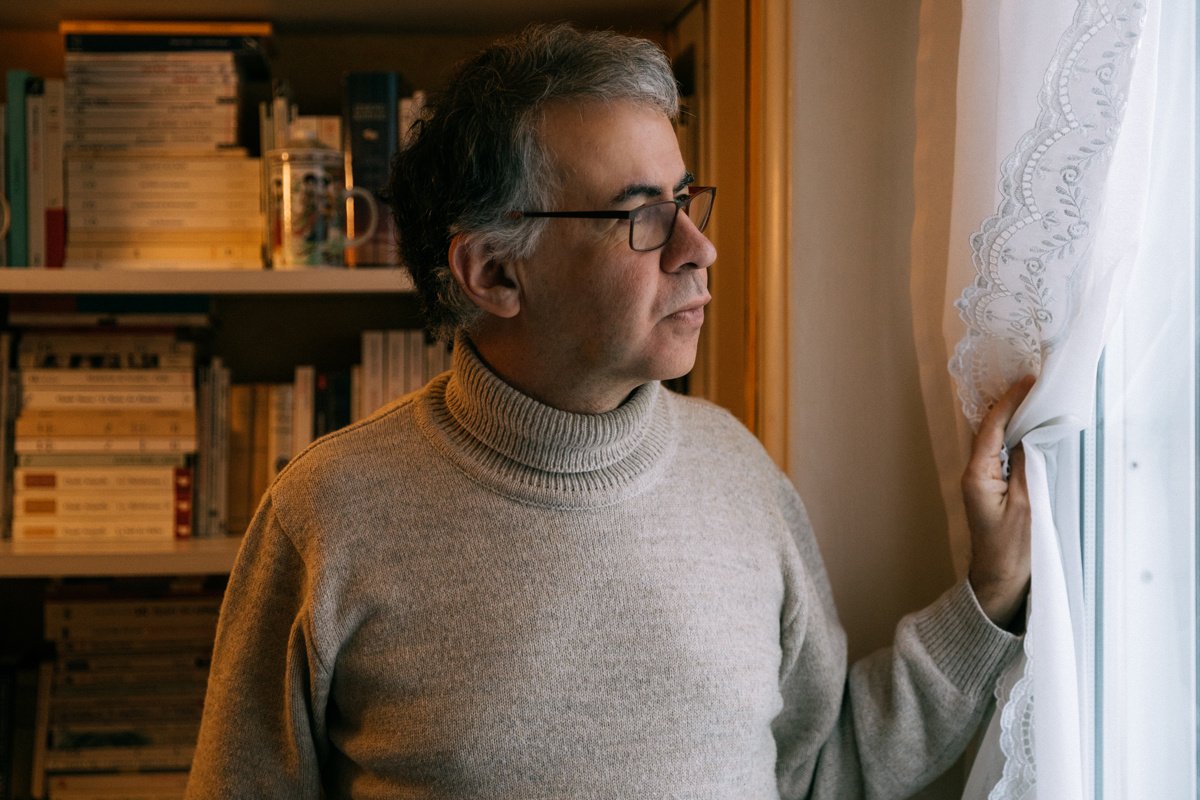“Il suffit de traverser la rue” d'Eric Faye : le roman d'une époque
25 janv. 2023 - mis à jour le 24 janv. 2023
6min

Le monde du travail s’est-il changé en une grande guerre de tous contre tous ? Dans son roman “Il suffit de traverser la rue” (éd. Seuil), Éric Faye raconte le quotidien de l’entreprise de presse MondoNews. Entré en bourse, le média doit faire face aux méthodes de management imposées par la nouvelle direction, basée à Seattle. Aurélien Babel, journaliste de 57 ans, navigue désormais entre management kafkaïen et plan social destiné à économiser des moyens. Mais ce “plan de départ volontaire", ne s'adresse pas à tous... Commence alors une lutte pour avoir le simple droit d’être viré.
Le titre de votre ouvrage, “Il suffit de traverser la rue”, fait référence à une phrase d’Emmanuel Macron de 2018, adressée à un chômeur longue durée. Ce roman est-il une réponse au Président de la République ?
Non, j’ai simplement choisi ce titre parce que cette phrase d’Emmanuel Macron résonnait très bien avec l’esprit du roman et ses personnages quinquagénaires, voire soixantenaires, qui sont assurés de ne jamais retrouver un travail nulle part. Le président de la République l’a prononcée un peu à la légère, et cela cadre bien avec un certain esprit des élites à la fin des années 2010 que je souhaitais représenter.
Vous racontez l’entrée en bourse de MondoNews, média dans lequel travaille votre journaliste et héros, Aurélien Babel. Vous avez vous-même été journaliste. Pourquoi avoir choisi de situer votre histoire dans ce secteur ?
Parce que j’y ai travaillé jusqu’à très récemment, et que je voulais me servir de cette expérience pour témoigner. Bien sûr, je suis passé de la réalité à la littérature en réécrivant certaines scènes, en inventant des personnages etc.
Je voulais aussi situer mon intrigue dans ce milieu parce que la marchandisation de l’information, qui est une transformation à l’œuvre dans les entreprises de presse, me paraît particulièrement dangereuse. Certaines entreprises du monde réel, comme celles que je décris dans mon roman, tendent à ne publier que les informations qui ont une chance de faire du clic, au détriment d’informations parfois plus cruciales. Cette évolution me paraît particulièrement inquiétante parce qu’une presse affaiblie c’est, par contamination, la démocratie qui est affaiblie. Si la presse n’a pas les coudées franches pour faire un métier de fond, enquêter, alors il n’y a plus de fact-checking et de contrepoids au discours diffusé par les différents pouvoirs, financiers, économiques, politiques.
Votre ouvrage est sous-titré “Petite saga des années 2010”. Ces transformations économiques sont-elles la résultante, selon vous, de la crise de 2008 ?
Cette période correspond plutôt à l’arrivée de nouvelles méthodes de gestion du personnel, qui se sont davantage diffusées dans les entreprises du secteur privé. Je souhaitais documenter ces transformations avec l’exemple de MondoNews, qui est une entreprise de presse très fragilisée non pas parce qu’elle marche mal, mais parce qu’elle est la proie d’une pensée financière qui dévoie le métier et la déontologie du journalisme.
Quelles sont les conséquences de cette financiarisation de MondoNews sur le quotidien des salariés ?
De plus en plus de tâches sont externalisées et délocalisées à l’étranger, notamment à des non-journalistes, que l’on peut se permettre de payer 600 euros nets par mois. Lorsque j’étais moi-même en entreprise, nous avions affaire à des relecteurs situés dans des pays d’Europe de l’Est, qui n’avaient aucune culture de l’actualité. À un moment, mon personnage, Aurélien Babel, dit : « On est en train d’inventer le journalisme sans journalistes. » J’ai vu cette tendance à l’œuvre. De façon embryonnaire, certes, mais c’est toujours comme ça que cela commence. Il y avait aussi beaucoup d’absurde. Je ne pouvais pas par exemple demander aux techniciens de réparer le matériel sans passer par une demande en anglais, au siège, situé en Inde. Le tout permettait probablement à la direction, basée elle aussi à l’étranger, d’économiser quelques centimes d’euros. Et de présenter, à la fin de l’année, de meilleurs résultats aux actionnaires. Finalement, je n’ai pas eu besoin d’inventer grand chose pour mettre en scène ces situations hautement burlesques, voire kafkaïennes. Le monde actuel, avec ses dérives techniciennes et bureaucratiques, fabrique déjà ces situations. Et ce que je voulais, c’est que ce livre ait une fonction d’alerte.
« Le simple accès à ce plan de départs volontaires est un parcours du combattant ! De nombreux critères de départage sont mis en œuvre pour sélectionner les salariés qui auront le privilège d’être virés » - Éric Faye, romancier et ancien journaliste
Vous montrez d’ailleurs que les salariés sont si acculés que tous n’auront même pas le droit à ce plan de départ “volontaire”.
Oui, parce que cela coûte cher à une entreprise. C’est extraordinaire quand on y pense ! Mon personnage Aurélien Babel voit les nouvelles méthodes de gestion arriver et se dit que s’il reste dans l’entreprise, son quotidien va devenir insupportable. Alors, à presque soixante ans, il se dit qu’il doit partir à tout prix, et qu’après tout il a bien mérité de se la couleur un peu douce. Sauf que le simple accès à ce plan de départs volontaires est un parcours du combattant ! De nombreux critères de départage sont mis en œuvre pour sélectionner les salariés qui auront le privilège d’être virés. Et même avec trente ans d’ancienneté, on n’a pas plus le droit de s’en aller que d’autres employés encore dans la vingtaine.
Et cela crée une méfiance incroyable entre les salariés, qui se demandent tous s’ils ne seront pas doublés par leurs collègues…
Il y a d’abord un fossé d’incompréhension qui se creuse entre ceux qui décident de partir, et ceux qui font le choix de rester. Le doute s’insinue de part et d’autre, et finalement, de fortes tensions éclatent entre les deux groupes. D’un côté, il y a une course pour plaire au patron et de l’autre, une foire d’empoigne pour être le premier à déposer son dossier de départ et avoir plus de points que son voisin.
La situation devient si pesante que votre personnage, qui voudrait initier une grève et lutter pour ses droits, essaie finalement de s’en aller également.
C’est un pur, Aurélien Babel. Il voudrait lutter mais constate qu’il n’y a pas d’élan collectif. Les syndicats baissent les bras et ne proposent rien pour s’opposer au projet de démantèlement des services de la nouvelle direction. C’est un désenchanté. Il essaie de rire des choses absurdes qu’il voit. Mais, au fond, il est très triste de cette absence de lutte collective.
Il y a une grande part de témoignage dans ce roman. J’ai moi-même eu affaire à des syndicats qui ne cherchaient qu’à nous obtenir une prime que la direction consentait d’entrée de jeu à nous offrir. Cela m’a beaucoup hanté, angoissé, de savoir que l’on aurait pu faire barrage. Que nous aurions pu, si nous en avions eu envie, nous mobiliser, organiser une grève totale. J’ai quitté l’entreprise en colère, de ne pas avoir réussi à opposer une résistance.
Vous n’êtes pas tendre avec les collègues de votre héros, qui refusent de s’engager dans une lutte syndicale… Comment expliquez-vous leur apathie?
Je ne l’explique pas. Mais ce que je constate c’est que les classes moyennes supérieures ont tendance à moins lutter lorsque leurs emplois sont menacés. C’est une classe qui a une éducation, des idées, pourrait se révolter. Elle vote souvent pour des partis réformistes voire assez révolutionnaires, mais dans les entreprises cela engendre des salariés très sages parce qu’ils ont un bon salaire et je crois que l’argent achète l’âme des gens. Le salut d’une société ne peut pas venir de ces classes moyennes. Elles ont beaucoup de mal à renoncer. On peut le voir au niveau de la transition écologique, la même classe sociale a beaucoup de difficultés à renoncer à l’aisance, à ses voyages en avion, en voiture. À son niveau de vie coûteux, en somme.
Ce que vous souhaitiez mettre en scène, finalement, c’est “la guerre de tous contre tous” ?
Cette idée de Thomas Hobbes (philosophe qui a popularisé cette expression dans Le Léviathan, ndlr.) est intéressante. Il y a cette idée, répandue chez les conservateurs, que nous sommes en lutte, que les ennemis sont les autres. Je n’y crois pas. Pour moi, cette vision est extrêmement négative. Aurélien Babel n’est pas mon narrateur pour rien. Il est en quelque sorte mon porte-voix.
Y a-t-il une morale à cette fable que vous nous racontez ?
Au lecteur de voir. Moi je me suis contenté de dresser le portrait de la fin des années 2010. Il n’y a pas de morale, pas de message, pas de solution. Je ne propose rien. Un roman c’est une auberge espagnole, à chacun de pêcher ce qu’il veut trouver. Si un lecteur trouve une raison d’espérer, tant mieux.
En écrivant ce livre, avez-vous l’impression de faire de la politique?
Oui. On est en plein dans les questions sociales avec une certaine vision du travail et de l’homme dans le monde du travail. Il n’est pas nécessaire d’être diplômé de Sciences Po pour comprendre que les méthodes de gestion qui dévastent MondoNews sont effrayantes. Cette idée que la mondialisation est synonyme de dumping social l’est aussi. La bonne mondialisation doit être un peu plus noble qu’une recherche permanente du dumping social que je décris.
En pleine réforme des retraites et d’allongement de la durée du travail en France, votre livre apporte un certain éclairage… Cette réforme vous fait-elle peur ?
Je crains que l’on ne soit dirigé par des robots-comptables. Pour l’avoir observé dans une entreprise privée, l’obsession de la direction est de se débarrasser des employés de plus de cinquante ans. Parce qu’ils ont les salaires les plus élevés, et qu’ils ne sont plus corvéables à merci, comme on peut l’être quand on est jeune et que l’on veut faire ses preuves. Et puis, je ne vois pas où est l’intérêt de voler du travail aux jeunes. Il y a, dans cette réforme, une absence d’horizon collectif et de vision globale de la société.
Article édité par Clémence Lesacq - Photo Thomas Decamps pour WTTJ

Inspirez-vous davantage sur : Mutations

Pauline Rochart : « Quitter la capitale, c’est troquer l’ambition pour l’ancrage »
Ils ont quitté Paris et les grandes villes pour retrouver leurs racines. Zoom sur ce retour aux sources avec Pauline Rochart.
20 févr. 2025

« Qu'est-ce que tu veux de plus ?! » : infos et absurdités sur la parité
« Avant 2022, il y avait plus d’hommes prénommés « Thomas » que de femmes dans les conseils d'administrations des grandes entreprises allemandes ! »
16 sept. 2024

David Le Breton : « En entreprise, nous sommes dorénavant seuls, ensemble »
« Il n’y pas pas d’éthique sans visage. » David Le Breton livre ses inquiétudes sur la qualité de nos relations au travail à l'ère du numérique.
23 juil. 2024

Société du matching : pourquoi la vie pro ne doit pas ressembler à Tinder
Pour Philippe Steiner et Melchior Simioni, le matching moderne dans le monde du travail individualise et dissout les collectifs. Tribune.
04 juil. 2024

« La valeur travail, qui nous pousse à produire toujours plus, c’est une arnaque ! »
Lydie Salvayre critique la valeur travail et prône la paresse dans son nouveau livre, questionnant notre rapport au travail et au bonheur.
17 juin 2024
La newsletter qui fait le taf
Envie de ne louper aucun de nos articles ? Une fois par semaine, des histoires, des jobs et des conseils dans votre boite mail.

Vous êtes à la recherche d’une nouvelle opportunité ?
Plus de 200 000 candidats ont trouvé un emploi sur Welcome to the Jungle.
Explorer les jobs